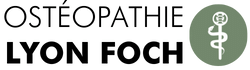CABINET d’ostéopathe lyon
Cabinet d’ostéopathe à Lyon 6 Foch spécialisé dans les soins ostéopathiques pour les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les sportifs et les adultes.
Je suis à la recherche d’un ostéopathe pour :


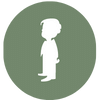
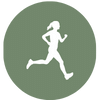


À propos de notre cabinet d’ostéopathe à Lyon
L’ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain susceptible d’en altérer l’état de santé.
C’est une pratique manuelle précise et minutieuse adroitement dosée et adaptée qui considère le corps humain dans sa globalité. Reposant sur l’anatomie et la physiologie du corps, l’ostéopathie est ainsi une pratique complémentaire de la médecine traditionnelle.
Situé dans le 6ème arrondissement de Lyon, notre Cabinet d’Ostéopathie exclusif prend en charge tous types de patients en provenance de Lyon, Villeurbanne & de la région environnante, et reste à votre disposition pour des conseils personnalisés ou pour des consultations urgentes.
Notre équipe d’ostéopathe à Lyon

Guillaume Corniau
Ostéopathe

Laura Wolf
Ostéopathe

Jean-Baptiste Dufour
Ostéopathe
Accès à notre cabinet d’ostéopathe
79 rue Duguesclin, 69006 Lyon

Bus
Ligne 27 ou C4 – Arrêt Foch

Métro
Ligne A – Station Foch

Parking
LPA Morand 11 bis place Maréchal Lyautey, 69006 Lyo
Cabinet d’ostéopathe à Lyon : Quelques uns de nos domaines d’intervention

Ostéopathe viscérale
Traitement des dysfonctionnements au niveau des organes internes

Ostéopathie myofaciale
Traitement des dysfonctionnements des fascias et des tissus vivants

Ostéopathie crânienne
Traitement des dysfonctionnements au niveau de la boite crânienne

Ostéopathie mâchoire
Traitement et normalisation des douleurs au niveau de la mâchoire

Ostéopathie gynécologique
Traitement des troubles de cycle, de fertilité et préparation de la grossesse

Ostéopathie pelvienne
Traitement des troubles au niveau du bassin, organes de reproduction
Ostéopathe à Lyon : Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que l’ostéopathie ?
L’ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain susceptible d’en altérer l’état de santé.
C’est une pratique manuelle précise et minutieuse adroitement dosée et adaptée qui considère le corps humain dans sa globalité. Reposant sur l’anatomie et la physiologie du corps, l’ostéopathie est ainsi une pratique complémentaire de la médecine traditionnelle.
Quel est le tarif pour une consultation au sein de votre cabinet d’ostéopathe à Lyon ?
Le prix d’une consultation au sein de notre cabinet d’ostéopathe à Lyon 6 est de 70€.
La consultation dure généralement entre 30 à 45 minutes en fonction du problème rencontré.
Quelle est la différence entre ostéopathe, étiopathe et chiropracteur ?
L’ostéopathie et l’étiopathie ont pour seule différence leur lieu d’origine.
L’étiopathie a été créé en Suisse par 2 ostéopathes, mais elle est à ce jour enseignée également en France. De fait ces deux pratiques ne diffèrent que peux. La prise en charge globale et la recherche de l’origine du problème font partis de leur fondements.
Cette profession et sa formation n’est ni reconnue ni règlementée à ce jour en France.
Dans les deux cas, il s’agit d’une approche globale du corps, d’une thérapie axée sur la recherche de la cause du dysfonctionnement, dans laquelle le seul outil du thérapeute est la main.
La chiropraxie est en revanche un exercice différent de l’ostéopathie. Le point commun est que les 2 techniques utilisent exclusivement des pratiques manuelles. Cependant, on peut distinguer 2 types de différences entre les 2 techniques :
1- La chiropraxie s’exerce uniquement dans le domaine articulaire, là où l’ostéopathie intervient dans les domaines ostéo-articulaire certes, mais aussi crânio-sacré (lien entre le crâne et le sacrum) et viscérale (actions spécifiques sur les viscères).
Les champs d’application de l’ostéopathie sont de ce fait plus vastes : Système orthopédique (Entorse, tendinites, lumbago, etc.), Séquelles de traumatismes (Accidents de voiture, fractures, etc.), Système digestif (Hernie hiatale, troubles digestifs, etc.), Système génito-urinaire (Douleurs gynécologiques, suivi de grossesse), Système O.R.L(Sinusite, migraines, asthme, etc.), Système cardio-vasculaire (Troubles circulatoires, hémorroïdes), Système neurologique (Sciatique, cruralgie, etc.)
2- Les modes d’exercice des 2 pratiques sont sensiblement différents. En effet, la chiropraxie utilise des manœuvres à bras de levier court (action près du point d’impact visé), ce qui implique une certaine force physique pour le thérapeute, et des manœuvres de « craquement » pour le patient. A contrario, l’ostéopathie utilise des manœuvres à bras de levier long (action portée plus loin du point d’impact visé), ce qui ne nécessite aucune force physique particulière de la part du thérapeute, mais en revanche une grande précision dans le geste, et permet au patient de bénéficier de manœuvres non douloureuses et sans « craquement ».
Les séances dans votre cabinet d’ostéopathe à Lyon sont-elles remboursées par la mutuelle ?
Non, les consultations de l’ostéopathe ne sont pas remboursées par la Sécurité Sociale. Le praticien est donc libre de fixer ses honoraires.
Mais plus de 85% des mutuelles en France remboursement les actes ostéopathiques.
Comment demander une prise en charge d’une séance d’ostéopathie par sa mutuelle ?
Vous devez envoyer une note d’honoraires à votre mutuelle. La note d’honoraire sera remise par l’ostéopathe après une séance.
Comment savoir si ma mutuelle rembourse les consultations chez l’ostéopathe ?
Il suffit de consulter la liste des mutuelles qui remboursement les séances d’ostéopathies :
Comment détecter une hernie ?
Tout d’abord, sachez qu’il existe plusieurs types d’hernies :
Comment détecter une hernie discale ?
Quand on a des douleurs locales type coup de poignard ou d’électricité pouvait donner des trajets nerveux le long du nerf (exemple dans la cuisse et la jambe pour le sciatique, dans la cuisse pour la crurale, dans le bras jusqu’à la main pour la Névralgie-Cervico-Brachiale (NCB).
La douleur peut être reproduite à l’hyperpression :
Comment détecter une hernie hiatale ?
Les symptômes fréquents sont diaphragmatique et paraoesophagienne: une symptomatique gastrique et oesophagienne est associée :
Comment détecter une hernie inguinale ?
Si aucun symptôme n’est détecté, il est possible de la découvrir suite à un examen médical ou dans le cas de complications. Le médecin examine alors attentivement le patient pour chercher les signes cliniques.
Cabinet d’ostéopathe à Lyon : Faut-il consulter quand on a des douleurs aux lombaires ?
Si vous souffrez d’un mal aux lombaires ou lumbago ou lombalgie, une consultation s’avère nécessaire en cas de :
Séance chez un ostéopathe : Qu’elles sont les effets secondaires ?
Lors d’une séance d’ostéopathie, le thérapeute utilise différentes techniques adaptées à votre cas. Certaines utilisent plus l’énergie du patient (techniques fasciales, tissulaires, viscérales) lorsque d’autres utilisent plus l’énergie du thérapeute (ostéopathie articulaire). Cependant, une fois la séance terminée, c’est l’ensemble de l’organisme qui réagit. Ce dernier « réinvestit » les zones qui avaient perdues de la mobilité.
Pour ce faire, les différentes structures du corps (muscles, fascias, tissus conjonctifs…) vont se rééquilibrer les unes par rapport aux autres. Ce phénomène va donc pouvoir générer des tensions, parfois plus sensibles que d’autres, à différents endort du corps. Egalement, le patient va pouvoir ressentir de la fatigue à des degrés différents en fonction de son organisme.
Le thérapeute n’a pas la possibilité de connaitre la façon dont vous réagirez. Ces effets secondaires peuvent être perceptibles jusqu’à une semaine après la séance.
Afin de les appréhender au mieux, mettez en place les conseils prodigués par votre ostéopathe et n’hésitez pas à nous contacter en cas d’interrogations.